Si l’industrie du drap a marqué l’histoire de Louviers, d’Elbeuf et de Rouen, Pont-de-l’Arche a aussi participé à la production textile en Normandie. Nous avons consulté les travaux d’Alain Becchia, auteur de la thèse La Draperie d’Elbeuf, que nous avons enrichis avec d’autres sources historiques afin de faire un état des lieux de nos connaissances dans ce domaine.

Une première tentative d’implantation en 1680
L’industrie drapière était en plein essor quand, en 1680, M. Chéron (officier du bailliage de Pont-de-l’Arche) et M. Le Bailly (du Vaudreuil) demandèrent aux autorités le droit d’ouvrir une manufacture de draps à Pont-de-l'Arche. Malgré le poids d’un officier du roi, leur demande fut refusée. Ces messieurs ne furent cependant pas pris au dépourvu car M. Chéron avait des intérêts dans une manufacture de Louviers[1]. Dès cette époque, les projets concernant Pont-de-l'Arche provenaient de personnes établies dans le milieu manufacturier et politique. Il ne pouvait en être autrement car le libéralisme économique n’était pas près de faire surface – il fallu attendre Turgot sous le règne de Louis XVI[2] – et chaque création de boutique ou de manufacture était soumise à l’autorisation du roi et des corporations[3]. Ils fixaient les prix de vente, les salaires et donnaient le droit ou non d’exercer ce métier. Qui plus est, la majeure partie des draps fabriqués était destinée à l’État, conférant à celui-ci un grand pouvoir sur la production.
1690-1712, une manufacture elbeuvienne s’implante
En 1690, une manufacture de drap obtint l’autorisation de s’implanter à Pont-de-l’Arche. L’habile travail de pression revint à deux fabricants elbeuviens, M. Delarue et M. Bourdon, qui associèrent leurs finances et leurs réseaux de relations pour accroitre leur production de draps de fine qualité, comme en Hollande et en Angleterre. Ces hommes installèrent, dès le début, 24 métiers à tisser et construisirent peu après deux relais dans des villages voisins[4]. Où se trouvait la manufacture de draps dans Pont-de-l’Arche ? Nous n’avons aucun document pour le préciser. Néanmoins, nous nous interrogeons sur une maison à pans de bois de la rue Julien-Blin (entre l’hôpital et l’encoignure de la rue du Président-Roosevelt). En effet, cette maison possède un toit débordant au-dessus de la rue. Ce type d’encorbellement servit, dans la rue Eau-de-Robec à Rouen, mais aussi à Louviers, à sécher les toiles en les suspendant à l’abri des intempéries. Cette maison serait-elle le seul témoin d’une rue occupée, un temps et pour partie, au travail du drap ?

La manufacture de Pont-de-l’Arche misait sur un travail de qualité. Ses propriétaires avaient fait venir de la main d’œuvre qualifiée de Hollande comme le note l’Intendant de Normandie en 1698 : Au Pontdelarche, six mestiers de draps très fins façon d’Angleterre dont les sillages sont conduits par des silleurs et des silleuses d’Hollande[5]. D’après les chiffres avancés par ce même intendant, M. Vaubourg de la Boudonnaye, nous avons dressé un tableau rassemblant les lieux de travail du drap en Normandie ; le total des métiers de chaque site ; le nombre de personnes employées ainsi que les pourcentages de ces données.
Répartition des métiers à tisser et des personnes employées dans le textile en Haute-Normandie en 1698
|
|
nombre de métiers |
métiers (en %) |
personnes occupées |
personnes occupées (en %) |
|
La Bouille |
23 |
2 % |
? |
? |
|
Louviers |
60 |
5 % |
1 900 |
10 % |
|
Darnétal |
102 |
8 % |
3 000 |
15 % |
|
Rouen |
398 |
30 % |
3 500 |
18 % |
|
Orival |
8 |
1 % |
? |
? |
|
Elbeuf |
370 |
28 % |
8 500 |
44 % |
|
Pont-de-l'Arche |
6 |
1 % |
? |
? |
|
Gournay |
40 |
3 % |
500 |
3 % |
|
Bolbec |
300 |
23 % |
2 000 |
10 % |
|
Totaux |
1 309 |
100 % |
19 400 |
100 % |
Pont-de-l'Arche était un site de production secondaire avec seulement 6 métiers soit 1 % de ces machines à tisser. Cependant, nous notons que l’Intendant déclara 6 métiers dans la ville alors qu’Alain Becchia s’est fondé sur des documents qui en avancent 24. Les 18 métiers manquants étaient-ils implantés dans d’autres villages ? Avaient-ils été arrêtés depuis 1690 ? Combien de personnes travaillaient à Pont-de-l’Arche ? Avec seulement 6 métiers, Pont-de-l'Arche représentait le 10e des métiers de Louviers qui occupaient 1 900 personnes. Si les métiers de Pont-de-l’Arche occupaient le 10e des tisseurs de Louviers cela représenterait tout de même près de 190 personnes ! Mais Pont-de-l’Arche était spécialisé dans le drap de haute qualité. Il devait produire en petite quantité avec moins de main-d’œuvre ce qui expliquerait les silences de l’Intendant sur les travailleurs de Pont-de-l’Arche et de La Bouille et Orival. Si nous reprenons les chiffres de Rouen, où il y avait 8 à 9 personnes pour un métier, Pont-de-l’Arche aurait occupé moins de 70 personnes.
Cet essor archépontain ne dura pas. En 1712, M. Delarue et M. Bourdon durent demander le renouvèlement de leurs privilèges. Mais, le vent qui fut favorable à leurs voiles en 1690 avait tourné : les corporations d’Elbeuf, Orival et Louviers, avaient obtenu des autorités le non renouvèlement des privilèges d’exploitation de la manufacture archépontaine. Voulant néanmoins ménager les deux entrepreneurs elbeuviens, un arrêt du 29 mars 1715 permit à Jacques et Thomas Bourdon frères, le déménagement de leur production aux Andelys ainsi que le dédommagement d’une partie des sommes investies. La concurrence locale était désormais amoindrie et la main d’œuvre plus abondante pour Elbeuf et Louviers.
Un métier à tisser (L'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert)
Après 1715, Louviers et Elbeuf étouffent les projets archépontains
En 1715, un procès engagé par la corporation d’Elbeuf parvint à empêcher l’implantation d’une nouvelle manufacture à Pont-de-l’Arche[6]. En 1755, le cas se présenta de nouveau, à la différence près que – bel élan de solidarité – la corporation de Louviers prêta main forte[7]. Dans cette même période, il y aurait peut-être eu une manufacture de cotonnades à Pont-de-l'Arche suite au travail de John Holker, ancien manufacturier de Manchester réfugié en France où il fut nommé inspecteur général des manufactures[8]. Ensuite, le travail textile se réduisit dans notre ville à une manufacture de couvertures de coton pluchées et non pluchées fondée en 1754 par M. Davoust et autorisée le 30 juillet par arrêt du Conseil. Cet établissement se maintint au moins trois ans mais n’a guère laissé de traces[9]. Enfin, une dernière tentative d’implantation a été enregistrée dans les archives. Il s’agit d’un certain M. Chevalier, d’Elbeuf, qui interrogea les autorités en 1790 pour fonder à Pont-de-l’Arche une manufacture de draps. Cette demande fut vaine[10]. Enfin, si aucune fabrique de drap n’existait à Pont-de-l’Arche en 1788, le textile occupait 37 personnes, comme le nota Bénédicte Delaune dans un mémoire de maitrise. Elle écrivit que « Le secteur textile apparaît assez faible à côté de villages comme Elbeuf et Louviers, grands centres manufacturiers. En fait, les principaux sont des cardeurs, cordiers, tailleurs ou basestaniers. Quelques marchands drapiers ou de toileries subsistent en l’an VI [1797-1798]. Ils disparaissent en l’an IX [1800-1801].[11] »
Le textile apparait encore dans l'histoire de la ville dans les déclarations faites en 1817 à l'occasion d'un recensement cantonal qui dénombra 60 broches chez Noël Postel, 360 chez Désiré Brunel et 164 chez Constant Brubel. Il dénombra aussi 240 broches, "soit deux métiers", chez Nicaise Vigor (Igoville) et d'autres broches à Martot, Saint-Pierre-de-Liéroult, Le Vaudreuil… En 1820, Pierre Louis Hédouin possédait 3 métiers à Pont-de-l'Arche où se trouvait aussi et Noël Potel, filateur en coton, propriétaire de 240 broches. Pour finir, en 1834, Alexandre Lequeux, "maître filateur", déclara 10 métiers soit 1 200 broches et Pierre Louis Hédouin, "filateur de coton", deux métiers à filer soit 250 broches[12] .
Bilan
Un rapide survol de la situation du textile à Pont-de-l’Arche montre que la croissance de cette industrie aurait pu toucher notre cité si le commerce avait été libre. De peur de perdre une main d’œuvre qualifiée, les corporations de Louviers et Elbeuf ont fait pression sur les autorités royales pour écraser la concurrence locale. Ce comportement, aux antipodes des intérêts des ouvriers, a laissé le champ libre au développement de l’industrie du chausson à partir des années 1830. En effet, les Archépontains, sans industrie, se sont engouffrés dans cette activité située à mi-chemin entre la cordonnerie et le textile. Une partie non négligeable des très nombreux cordonniers de la ville (23 en 1788) ont cousu des semelles de cuir sur les chaussons tressés avec des chutes de drap d’Elbeuf par des dizaines puis des centaines de chaussonniers… C’était le cas d’Antoine Ouin qui constitua officiellement la première société de chaussons de Pont-de-l’Arche en 1833, lui qui était cordonnier dans la droite lignée de ses ancêtres. La Société nouvelle Chaussures Marco est aujourd’hui sa digne héritière…
Sources
Becchia Alain, La draperie d’Elbeuf (des origines à 1870), Rouen, Publications de l’université de Rouen, 2000, 869 pages ;
Delaune Bénédicte, Pont-de-l’Arche, population, pouvoirs municipaux et société à la fin du XVIIIe siècle et pendant la Révolution, mémoire de maitrise dirigé par Claude Mazauric, université de Rouen, 1992, 130 pages ;
Launay Armand, Pont-de-l’Arche, cité de la chaussure : étude sur un patrimoine industriel normand depuis le XVIIIe siècle, mairie de Pont-de-l’Arche, 2009, 52 pages ;
Lepage Albert, « Essai historique sur le commerce et l’industrie au Pont-de-l'Arche depuis sa fondation jusqu’à nos jours suivi d’une notice sur le chausson de lisière », 1911, in Bulletin de la Société d’études diverses de l’arrondissement de Louviers, tome XIII ;
Vaubourg [l. de la Bourdonnaye] Mémoire de la généralité de Rouen, 1698, 86 folio, 244 x 183 cm, relié. Bibliothèque municipale du Havre : Mss 525.
[1] Becchia Alain, La draperie d’Elbeuf…, page 58 (n 232).
[2] On consultera avec intérêt la biographie écrite par Jean-Pierre Poirier : Turgot, laissez-faire et progrès social, Paris, Perrin, 1999, 459 pages.
[3] Associations institutionnelles de propriétaires de boutiques d’un même secteur d’activité dans une ville (les boulangers de Rouen, les cordonniers de Pont-de-l'Arche…).
[4] Becchia A., La draperie d’Elbeuf, page 58.
[5] Vaubourg, Mémoire de la généralité de Rouen, page 70.
[6] Becchia A., La draperie d’Elbeuf, page 135.
[7] Becchia A., La draperie d’Elbeuf, page 142.
[8] Becchia A., La draperie d’Elbeuf, page 160.
[9] Lepage Albert, « Essai historique sur le commerce et l’industrie au Pont-de-l'Arche… », page 83.
[10] Archives municipales de Pont-de-l’Arche.
Armand Launay
Pont-de-l'Arche ma ville
commenter cet article …

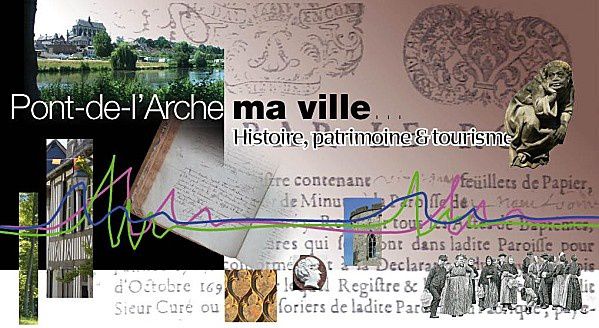



/image%2F0550649%2F201304%2Fob_9e233b1c7beafe9c4121bd3e5eded037_bandeau-blog.JPG)
/image%2F0550649%2F20210101%2Fob_b51755_mymap-zoom-pa.jpg)
/idata%2F0316469%2FAmfreville-et-Poses%2FEcluses-d-Amfreville-sous-les-Monts-7-.JPG)
/idata%2F0316469%2FPont-Saint-Pierre-du-Vauvray--1947-%2FPont-de-Saint-Pierre-du-Vauvray-14-.JPG)
/idata%2F0316469%2FCartes-postales-2%2FCarte-postale-de-Pont-de-l-Arche--396-.jpg)
/idata%2F0316469%2FCartes-postales-1%2FCarte-postale-de-Pont-de-l-Arche--199-.jpg)
/idata%2F0316469%2FAlizay%2FAlizay--15-.jpg)
/idata%2F0316469%2FCriquebeuf---Martot%2Fcriquebeuf.jpg)