Tourville-la-rivière est une étonnante commune du méandre de Seine d’Elbeuf. Elle est surprenante par le contraste offert entre, d’un côté, l’ancien village au pied du coteau et, de l’autre côté, la zone commerciale qui s’étend à perte de vue dans la plaine alluviale.
Ce toponyme provient du temps où des scandinaves se voyaient attribuer des domaines, sûrement en remerciement de leur service pour les ducs de Normandie. Il doit s'agir du nom d’un homme, Thor, comme le dieu-tonnerre ; un homme qui devint propriétaire d’une villa, c’est-à-dire un domaine rural, et aussi sûrement de l’ile Sainte-Catherine qui fut appelée Thorholmr (“l’ile de Thor”) et qui servit de camp aux Normands. Il faut sûrement imaginer autour de ce propriétaire des serviteurs et quelques dizaines de familles de paysans-pêcheurs.
Le domaine de Thor dût être proche de l’église Saint-Martin de nos jours. Saint-Martin est d’ailleurs un nom ancien parmi les saints vénérés. Il se rattache au haut Moyen Âge et le nom de Torvilla a remplacé un nom roman plus ancien. Pourquoi s’installer en ce lieu ? Il faut concevoir le fond de la vallée comme un espace moins asséché que de nos jours et régulièrement exposé aux crues du fleuve. On peut assez raisonnablement penser qu’un bras de Seine arrivait non loin du pied du coteau, à Tourville. Quant au coteau, il devait fournir de l’eau nécessaire à l’établissement humain et ce grâce à ce vallon qui remonte vers le bois Bocquet. Tourville est aussi situé au pied du col menant vers les Bocquets, hameau de Sotteville-sous-le-val. Les pentes sont donc ici plus douces qu’ailleurs le long du coteau. Défrichées, elles durent servir à maintes activités comme l’élevage, la culture, les vergers, la vigne peut-être. Saint-Martin se trouve donc au-dessus d’une sorte de carrefour entre le chemin qui devait longer la vallée, même en période de crue, le passage vers le col des Bocquets et le chemin menant au vallon vers le bois Bocquet.
Le cimetière gallo-romain du “col de Tourville”
En 1863, l’abbé Cochet fit paraitre dans La Revue de la Normandie un article intitulé “Notice sur les sépultures romaines du IVe et du Ve siècle trouvées à Tourville-la-rivière”. Il fit état de découvertes commencées en 1842 à l’occasion du percement du tunnel de chemin de fer du côté du versant de Sotteville-sous-le-val. Ces découvertes sottevillaises, profitables aux brocanteurs, ont été faites au-dessus de l’entrée du tunnel ferroviaire, dans une sablière, et un peu aussi de l’autre côté du vallon au champ dénommé Callouet, alors appelé la Callouette. L’abbé Cochet entreprit des fouilles en 1862. Il y trouva des “cercueils de pierre, des monnaies antiques, des objets en fer et en bronze, mais surtout un grand nombre de vases en terre et en verre. Tous ces objets entouraient ou escortaient des squelettes humains.” Nous avons reproduit une page de dessins représentant ces vases pour illustrer cet article. Ce qui est précisément intéressant dans ces découvertes, comme le note l’abbé Cochet, est la date tardive de ces objets, à la toute fin de l’Antiquité. En règle générale les vestiges retrouvés dans la région datent des IIe, IIIe et IVe siècles, ceux d’une période prospère, notamment démographiquement. L’abbé Cochet révèle l’intérêt de ces découvertes : “Ce sont des intermédiaires entre les incinérations du Haut-Empire et les inhumations franques”, courantes dans la région. Bien que des croix de saint André figurassent sur des cercueils de plomb, l’auteur ne croit pas avoir affaire à de premières inhumations chrétiennes, ceci à cause de dispositifs destinés à accueillir des offrandes bien païennes. L’auteur voit aussi quelques analogies entre des ceinturons et vases sottevillais et des vestiges francs de Martot. Sans entrer dans le détail, ce qui nous intéresse ici est la forte probabilité que des villas, des fermes-hameaux, existassent non loin de ce cimetière, utilisé durant cinq siècles, sûrement là où se trouve de nos jours La Nos Robin, ancien hameau devenu quartier pavillonnaire de la rue Édith-Piaf. C’est en ce sens que ces découvertes peuvent être raccrochées à l’histoire de Tourville aussi bien qu’à Sotteville. Peut-on imaginer un paysage proche de celui de nos jours, c’est-à-dire plutôt déboisé et exploité ? Peut-on imaginer des terres dévolues à l’élevage, des bois-taillis, des vergers, des vignes et des villas éparses ?
Le site Internet de l'INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives) présente articles et vidéos sur le site de la Fosse-Marmitaine (capture d'écran du site Internet).
Un site archéologique d’intérêt international
Le site de l’INRAP résume en sept articles les fouilles réalisées à Tourville. La plus notable est celle de 2014 où furent mise au jour trois os fossiles du bras gauche d’un pré-néandertalien appelé “l'Homme de Tourville-la-Rivière”. L’âge de ces fossiles est estimé entre 236 000 à 183 000 avant Jésus-Christ. Il s’agit d’une découverte majeure pour l’Europe du nord-ouest qui reste pauvre en découvertes pré-néandertaliennes.
Cette découverte est due à la nature des sols de Tourville. Dans la vallée de Seine, des alluvions se sont déposées, entre 350 000 et 130 000 ans avant notre ère, et ont protégé ‒ en les recouvrant ‒ de nombreux restes d’animaux eux aussi charriés par le fleuve. Puis, le lit de la Seine s’est approfondi et déplacé. C’est l’exploitation de carrières de sable et gravier qui a récemment permis d’exhumer de nombreux objets parmi 30 mètres de profondeur de sol fouillés. Cela a commencé en 2005 mais c’est surtout en 2010 qu’une fouille approfondie et sur un hectare fut entreprise à La Fosse Marmitaine, près de Gruchet, à l’ouest de la commune et au nord du clocher de Freneuse.
Les vestiges sont nombreux car ils correspondent à une ère interglaciaire où un climat tempéré était propice à la propagation des espèces. Les archéologues ont donc porté à notre connaissance la présence du cerf, de l’auroch, de deux espèces d'équidés, du sanglier et du rhinocéros. Côté carnivore, le rapport grand public de la fouille, mentionne “le loup, le renard, l'ours et la panthère.”
L’activité humaine, surtout la chasse, est traçable par la découverte de 500 silex taillés, relativement peu nombreux car les hommes étant nomades, mais démontrant une haute technicité rattachable à l’industrie lithique dite de Levallois.
Tourville a aussi bénéficié de fouilles au Clos bâtard, aujourd’hui en eau, où des trous de poteaux démontrent l’existence d’une maison commune.
Un centre autour de l’église Saint-Martin
Le centre-village a subi des pertes immobilières, depuis ces dernières décennies, comme le montre une comparaison avec les cartes postales des années 1910. Le village a quelque peu perdu de sa ruralité et de sa densité de population malgré les efforts des municipalités successives pour maintenir des services publics et des résidences. Des zones pavillonnaires ont été érigées en périphérie qui ont participé du dépeuplement du centre.
Le principal lieu patrimonial est constitué par “le château”, la maison de style directoire, au chevet de l’église. D’après Benoît Thieuslin, dont nous parlons ci-dessous, elle se situe à l’endroit de la ferme de Guillaume de Tourville, seigneur du lieu. Il ne serait pas étonnant qu’on tienne ici le fief, à proprement parler, de Tourville, où un seigneur s’établit et dota la chapelle puis l’église paroissiale. L’église, un temps dirigée par les moines de Jumièges, est placée sous le patronage de saint Martin, ce qui indique que le culte est très ancien. La base Mérimée du Ministère de la culture avance qu’un édifice roman exista dont il ne reste que des pierres de soubassement. La tour-clocher située à la croisée du transept remonte, elle, au XVIe siècle. Elle est à la fois imposante, avec ses contreforts rappelant un peu l’église de Freneuse, et engoncée étant donné qu’il manque un étage qui lui aurait permis de dégager la flèche polygonale du clocher vers le ciel. Le reste de l’édifice a fait l’objet d’importantes reconstructions : le chœur, en 1832 ; la nef, en 1839 ; les chapelles, en 1879. L’église n’est pas protégée par le service des Monuments historiques. Toutefois neuf objets liturgiques sont classés, plutôt de la période renaissante ; huit autres signalés dans la base POP du Ministère de la culture.
Des fiefs nobiliaires dans la plaine
Tourville a la chance de bénéficier d’un ouvrage d’histoire réalisé en 2009 par Benoît Thieuslin : Tourville terre d'histoire. L’auteur se place dans les pas de René et Thérèse Houdin qui se sont précédemment intéressés à ce même sujet en publiant, notamment, Tourville, notre village, en 1983. Outre sa volonté pédagogique, Benoît Thieuslin a le mérite de retracer les différents fiefs nobiliaires de la paroisse de Tourville, c’est-à-dire les domaines possédés par des familles nobles qui y résidaient ou, tout du moins, en percevaient des bénéfices et un titre. Citons ainsi le manoir de Gruchet, près de Cléon, entièrement rasé depuis la dernière guerre. Le manoir de Bédanne, largement remanié au XIXe siècle, ne conserve du XVIe siècle que son colombier et une chapelle attenante au bâtiment principal. Le manoir du Port-d’Oissel, non loin d’Ikea de nos jours, tirait son nom d’un passage établi en 1198 entre Oissel et Tourville. Une charge de portier exista à partir de 1128. Il ne reste de cet ancien domaine qu’un colombier du XVIe siècle. Citons enfin la ferme du Hamel, vers Le Port-Saint-Ouen, avec des bâtiments plus récents.
Cartes postales des années 1910 offrant des vues sur les hameaux de Tourville, anciens fiefs nobiliaires.
Comparaison entre une vue aérienne des années 1950 et la vue aérienne de 2018 (captures d'écrans du site Géoportail).
Centre commercial ou périphérie ?
Tourville était principalement une paroisse agricole. Elle était aussi une étape fluviale et routière. Cette fonction d’étape a commencé à diminuer avec l’arrivée de la voie de chemin de fer entre Paris et Rouen, en 1842, où une halte fut ouverte à Tourville. Des Tourvillais devinrent des ouvriers des usines d’Oissel et de Pont-de-l’Arche. Le percement de l’autoroute de Normandie en 1970 a renforcé les besoins en sables et graviers déjà importants en raison des vastes constructions immobilières. Les sols de Tourville se sont largement transformés en carrières et sablières. L’abandon de ces carrières, une fois épuisées, a donné lieu à la création d’étangs. L’un d’entre eux est devenu la base de loisirs de Bédanne.
L’autoroute a facilité le franchissement de la Seine, devenu imperceptible aux automobilistes. En 1971, la zone d’activités économiques du Clos aux antes ouvrit juste après l’ouverture de l’autoroute. Elle est depuis destinée aux grandes surfaces commerciales nécessairement accessibles par la route. C’est en 1990 que s’ouvre le Centre commercial dit de Tourville-la-rivière. Il s’agit d’une vaste galerie couverte au milieu de laquelle se trouve un hypermarché appelé Carrefour. Avec celui de Barentin, Tourville accueille le plus grand centre commercial de la périphérie de l’agglomération rouennaise. Cette révolution du paysage tourvillais témoigne des nouvelles modalités de l’économie. La concentration capitaliste a franchi un nouveau seuil : la consommation s’est massifiée que ce soit par le désir des clients ou la nécessité du profit ; la grande surface a supplanté le commerce de détail ; le transport routier est devenu prépondérant, aux dépens de la marche ou du ferroviaire ; l’économie repose désormais beaucoup sur les importations et non sur la production locale. Il en ressort une impression étonnante : les cœurs de villes et villages sont relativement désertés. La sociabilité est bousculée. Le nom même de Tourville-la-rivière semble être celui du centre commercial, dans bien des esprits, et non celui du petit centre village blotti autour de Saint-Martin et des hameaux disséminés entre les étangs, les carrières et les entrepôts. Où se trouve le centre ? Où se trouve la périphérie ?
Entre-t-on dans le village ou un centre commercial dénommé Tourville-la-rivière ? Cliché de @nika de Norm@ndie, aimable bloggeuse de Tourville-la-rivière que nous remercions pour la photographie ci-dessus, datant de 2013.
commenter cet article …

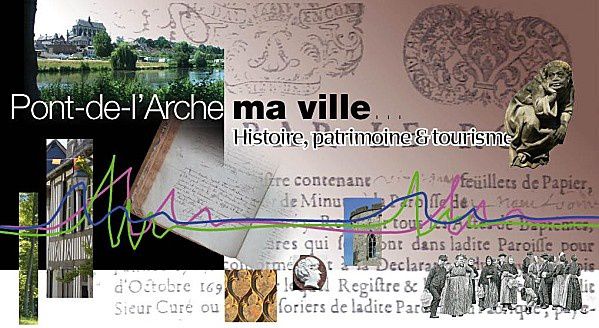
/image%2F0550649%2F20210413%2Fob_ffb31b_808-001.jpg)
/image%2F0550649%2F20210413%2Fob_bb5d0d_ign-actuelle-tourville.jpg)
/image%2F0550649%2F20210413%2Fob_a0c151_abbe-cochet-1863-revue-normandie-t.jpg)
/image%2F0550649%2F20210413%2Fob_b8a8b9_inrap-tourville.jpg)
/image%2F0550649%2F20210413%2Fob_40f9a9_img-1020.JPG)
/image%2F0550649%2F20210413%2Fob_b757e5_img-1022.JPG)
/image%2F0550649%2F20210413%2Fob_5a2bac_img-1024.JPG)
/image%2F0550649%2F20210413%2Fob_18ca0b_img-1026.JPG)
/image%2F0550649%2F20210413%2Fob_9c8445_img-1027.JPG)
/image%2F0550649%2F20210413%2Fob_8d3c79_img-1028.JPG)
/image%2F0550649%2F20210413%2Fob_86d015_img-1029.JPG)
/image%2F0550649%2F20210413%2Fob_a0b8d3_157-001.jpg)
/image%2F0550649%2F20210413%2Fob_468e21_823-001.jpg)
/image%2F0550649%2F20210413%2Fob_3010a6_996-001.jpg)
/image%2F0550649%2F20210413%2Fob_590d4f_628-001.jpg)
/image%2F0550649%2F20210413%2Fob_740d0b_ferme-du-port-d-oissel.jpg)
/image%2F0550649%2F20210413%2Fob_3b0cfb_route-de-bedanne.jpg)
/image%2F0550649%2F20210413%2Fob_7c2a8d_vue-aerienne-contemporaine-tourville.jpg)
/image%2F0550649%2F20210413%2Fob_183c03_vue-aerienne-vers-1950-tourville.jpg)
/image%2F0550649%2F20210413%2Fob_27f591_161-001.jpg)
/image%2F0550649%2F20210413%2Fob_15f986_553-001.jpg)
/image%2F0550649%2F20210413%2Fob_a55e88_565-001.jpg)
/image%2F0550649%2F20210413%2Fob_71c840_879-001.jpg)
/image%2F0550649%2F20210413%2Fob_601b3a_belle-vue-du-relais.jpg)
/image%2F0550649%2F20210413%2Fob_508728_dsc02804.JPG)



/image%2F0550649%2F20210406%2Fob_761a84_dsc01883.JPG)
/image%2F0550649%2F20210406%2Fob_ae6c40_section-a-du-hameau-de-martot-plan-ca.jpg)
/image%2F0550649%2F20210406%2Fob_d811e0_section-b-de-martot-plan-cadastral-18.jpg)
/image%2F0550649%2F20210406%2Fob_c28995_martot-et-criquebeuf-vue-aerienne-201.jpg)
/image%2F0550649%2F20210406%2Fob_2ea693_martot-et-criquebeuf-vue-aerienne-ver.jpg)
/image%2F0550649%2F20210406%2Fob_4cf9d9_martot-la-crue-de-la-seine-le-villa.jpg)
/image%2F0550649%2F20210406%2Fob_887599_martot-1870-abbe-cochet-1.jpg)
/image%2F0550649%2F20210406%2Fob_d5ba74_martot-1870-abbe-cochet-2.jpg)
/image%2F0550649%2F20210406%2Fob_b97aa5_martot-1870-abbe-cochet-3.jpg)
/image%2F0550649%2F20210406%2Fob_8090e4_section-a-du-hameau-de-martot-plan-ca.jpg)
/image%2F0550649%2F20210406%2Fob_193922_chateau-de-martot-vue-arriere-cp-d.jpg)
/image%2F0550649%2F20210406%2Fob_78ba37_martot-le-barrage-8-fi-394-11-ad2.jpg)
/image%2F0550649%2F20210404%2Fob_e3d419_vue-de-gouy-par-dumee.jpg)
/image%2F0550649%2F20210404%2Fob_533fa9_entree-de-la-grotte-de-gouy-sur-la-rn.jpg)
/image%2F0550649%2F20210404%2Fob_4678ca_detail-du-cheval-gouy-extrait-du-ga.jpg)
/image%2F0550649%2F20210404%2Fob_96bc07_2590398.jpg)
/image%2F0550649%2F20210404%2Fob_77201b_1518448499-76-p.jpg)
/image%2F0550649%2F20210404%2Fob_ea1606_img-0874.JPG)
/image%2F0550649%2F20210404%2Fob_9a0ad8_img-0875.JPG)
/image%2F0550649%2F20210404%2Fob_03fe69_img-0876.JPG)
/image%2F0550649%2F20210404%2Fob_5e398d_img-0877.JPG)
/image%2F0550649%2F20210404%2Fob_5562a5_img-0878.JPG)
/image%2F0550649%2F20210404%2Fob_749160_img-0879.JPG)
/image%2F0550649%2F20210321%2Fob_119f37_12fi107-paroisse-de-sotteville-sous-le.jpg)
/image%2F0550649%2F20210321%2Fob_b84351_aug01547.JPG)
/image%2F0550649%2F20210321%2Fob_3357b2_aug01554.JPG)
/image%2F0550649%2F20210321%2Fob_84d9fe_dsc-1032.JPG)
/image%2F0550649%2F20210321%2Fob_fb10b0_dsc-1035.JPG)
/image%2F0550649%2F20210321%2Fob_55f48a_p1060439.JPG)
/image%2F0550649%2F20210321%2Fob_44f6c9_p1170870.JPG)
/image%2F0550649%2F20210321%2Fob_082158_croix-de-cimetiere-sotteville-6fi9.jpg)
/image%2F0550649%2F20210321%2Fob_72719a_monvillagenormand-fr.jpg)
/image%2F0550649%2F20210321%2Fob_bb418f_aug01555.JPG)
/image%2F0550649%2F20210321%2Fob_bf7818_p1060439.JPG)
/image%2F0550649%2F20210321%2Fob_350260_p1180435.JPG)
/image%2F0550649%2F20210321%2Fob_fd8b63_p1180436.JPG)
/image%2F0550649%2F20210321%2Fob_ac363e_p1170872.JPG)
/image%2F0550649%2F20210321%2Fob_4ffb3b_p1170873.JPG)
/image%2F0550649%2F20210321%2Fob_eac6e0_p1170874.JPG)
/image%2F0550649%2F20210321%2Fob_a4e0ac_p1180432.JPG)
/image%2F0550649%2F20210321%2Fob_d421cb_le-chateau-de-val-freneuse-par-nika.jpg)
/image%2F0550649%2F20210524%2Fob_2975f7_qua-vreville-la-poterie-fra-da-ric-ma.jpg)
/image%2F0550649%2F20210314%2Fob_c1fe8b_quevreville-par-frederic-menissier.jpg)
/image%2F0550649%2F20210314%2Fob_c1f455_quevreville-vue-aerienne-contemporai.jpg)
/image%2F0550649%2F20210314%2Fob_50b071_quevreville-vue-aerienne-vers-1950.jpg)
/image%2F0550649%2F20210314%2Fob_852a02_800px-blason-quevreville-la-poterie-s.png)
/image%2F0550649%2F20210314%2Fob_fec665_pv-commission-antiquites-seine-inf-v.jpg)
/image%2F0550649%2F20210314%2Fob_bd2220_plan-terrier-detail-eglise-et-fief.jpg)
/image%2F0550649%2F20210314%2Fob_c9bfe4_img-0816.JPG)
/image%2F0550649%2F20210314%2Fob_1875f9_grange-interieur-detail-de-la-char.jpg)
/image%2F0550649%2F20210314%2Fob_7adf09_grange-mur-pignon-avec-conterfort-ac.jpg)
/image%2F0550649%2F20210314%2Fob_7ebce2_grange-vue-d-ensemble-sur-le-mur-go.jpg)
/image%2F0550649%2F20210314%2Fob_cbb301_grange-vue-d-ensemble-sur-le-mur-go.jpg)
/image%2F0550649%2F20210314%2Fob_e40c2c_plan-de-l-eglise-ad76-cliches-sur.jpg)
/image%2F0550649%2F20210314%2Fob_cdf2d1_eglise-notre-dame-1957-ad76-clicha.jpg)
/image%2F0550649%2F20210314%2Fob_5fbaff_eglise-notre-dame-choeur-1947-ad76.jpg)
/image%2F0550649%2F20210314%2Fob_25bf0a_img-0811.JPG)
/image%2F0550649%2F20210314%2Fob_f81e2c_img-0817.JPG)
/image%2F0550649%2F20210314%2Fob_5a682d_quevreville-par-frederic-menissier.jpg)
/image%2F0550649%2F20210314%2Fob_2f1c84_218-001.jpg)
/image%2F0550649%2F20210314%2Fob_18136a_325-001.jpg)
/image%2F0550649%2F20210314%2Fob_15f961_515-001.jpg)
/image%2F0550649%2F20210314%2Fob_9ff296_quevreville.jpg)
/image%2F0550649%2F20210314%2Fob_b4479a_plan-terrier-detail-au-sud-de-l-egl.jpg)
/image%2F0550649%2F20210314%2Fob_d5ea89_plan-terrier-detail-eglise-et-fief.jpg)
/image%2F0550649%2F20210314%2Fob_45580f_plan-terrier-la-forge-cote-12fi101.jpg)
/image%2F0550649%2F20210314%2Fob_057b15_plan-terrier-le-fresnay-cote-12fi101.jpg)
/image%2F0550649%2F20210227%2Fob_450982_meandre-daubeuf.jpg)
/image%2F0550649%2F20210227%2Fob_97e533_herqueville-carte-d-etat-major-1840.jpg)
/image%2F0550649%2F20210227%2Fob_a3362d_plan-cadastral-herqueville.jpg)
/image%2F0550649%2F20210227%2Fob_15a585_tabernacle-et-deux-tableaux-herquevill.jpg)
/image%2F0550649%2F20210227%2Fob_4828f5_herqueville-ferme-normande-proprie.jpg)
/image%2F0550649%2F20210227%2Fob_b4310e_chateau-renault-2-wiki.jpg)
/image%2F0550649%2F20210320%2Fob_1f8f1a_herqueville-par-frederic-menissier.jpg)
/image%2F0550649%2F20210425%2Fob_5cd5f5_quatremare-route-de-louviers-8-fi-4.jpg)
/image%2F0550649%2F20210425%2Fob_c47c0a_damneville-7-par-frederic-menisser.jpg)
/image%2F0550649%2F20210425%2Fob_0ca3f1_damneville-5-par-frederic-menisser.jpg)
/image%2F0550649%2F20210425%2Fob_fee263_damneville-9-par-frederic-menisser.jpg)
/image%2F0550649%2F20210222%2Fob_8f3dbb_quatremare-carte-etat-major-1840.jpg)
/image%2F0550649%2F20210425%2Fob_61cdf9_v-dartois-quatremare.jpg)
/image%2F0550649%2F20210222%2Fob_5bd7bb_0-albert-maurice-jean-hazard.jpg)
/image%2F0550649%2F20210425%2Fob_b51fa6_gabriel-bretocq-1873-1961-ext-cot.jpg)
/image%2F0550649%2F20210425%2Fob_0b516e_quatremare-interieur-de-l-eglise.jpg)
/image%2F0550649%2F20210425%2Fob_cff6ae_quatremare-l-ecole-8-fi-483-2.jpg)
/image%2F0550649%2F20210425%2Fob_04984c_quatremare-la-mairie-et-la-place-8.jpg)
/image%2F0550649%2F20210425%2Fob_88b796_quatremare-27-monument-des-deux-gu.jpg)
/image%2F0550649%2F20210425%2Fob_ba322f_damneville-par-frederic-menisser-en.jpg)
/image%2F0550649%2F20210222%2Fob_76986d_2590450.jpg)
/image%2F0550649%2F20210222%2Fob_75628f_la-betterave-a-sucre-a-tostes.jpg)
/image%2F0550649%2F20210222%2Fob_ae1617_p2590375.jpg)
/image%2F0550649%2F20210222%2Fob_aad2d1_p2590362.jpg)
/image%2F0550649%2F20210222%2Fob_989e94_p2590413.jpg)
/image%2F0550649%2F20210202%2Fob_5acf92_pinterville-carte-d-etat-major-vers.jpg)
/image%2F0550649%2F20210202%2Fob_e1980b_pinterville-carte-toponymique.jpg)
/image%2F0550649%2F20210202%2Fob_8e312c_pinterville-carte-de-cassini.jpg)
/image%2F0550649%2F20210202%2Fob_3af15b_p2590760-min.jpg)
/image%2F0550649%2F20210202%2Fob_6bfaa0_p2590761-min.jpg)
/image%2F0550649%2F20210202%2Fob_68ae11_pierre-le-pesant-de-boisguilbert.jpg)
/image%2F0550649%2F20210202%2Fob_f93130_pinterville-27-le-chateau-1906.jpg)
/image%2F0550649%2F20210202%2Fob_0a5776_p2590762-min.jpg)
/image%2F0550649%2F20210202%2Fob_699dfa_pinterville-27-l-eglise-1926.jpg)
/image%2F0550649%2F20210202%2Fob_4e00e5_charpillon-et-caresme.jpg)
/image%2F0550649%2F20210202%2Fob_c40e2e_pere-laval.jpg)
/image%2F0550649%2F20210425%2Fob_68e797_surville-3-par-frederic-menissier-e.jpg)
/image%2F0550649%2F20210119%2Fob_351504_surville-carte-topographique-ign.jpg)
/image%2F0550649%2F20210425%2Fob_bbd0ac_cpa-surville-27-paturages-normands.jpg)
/image%2F0550649%2F20210425%2Fob_3a600c_surville-27-route-de-louviers.jpg)
/image%2F0550649%2F20210425%2Fob_f20c52_423-001.jpg)
/image%2F0550649%2F20210425%2Fob_73e389_574-001.jpg)
/image%2F0550649%2F20210425%2Fob_18b103_626-001.jpg)
/image%2F0550649%2F20210425%2Fob_df7000_915-001.jpg)
/image%2F0550649%2F20210425%2Fob_5d88e7_994-001.jpg)
/image%2F0550649%2F20210425%2Fob_786642_surville-2-par-frederic-menissier-e.jpg)
/image%2F0550649%2F20210425%2Fob_99d941_surville-1-par-frederic-menissier-e.jpg)
/image%2F0550649%2F20210119%2Fob_1e90d6_surville1.jpg)
/image%2F0550649%2F20210119%2Fob_87f6eb_dolmen-de-surville-dessine-par-leon.jpg)
/image%2F0550649%2F201304%2Fob_9e233b1c7beafe9c4121bd3e5eded037_bandeau-blog.JPG)
/image%2F0550649%2F20210101%2Fob_b51755_mymap-zoom-pa.jpg)
/idata%2F0316469%2FAmfreville-et-Poses%2FEcluses-d-Amfreville-sous-les-Monts-7-.JPG)
/idata%2F0316469%2FPont-Saint-Pierre-du-Vauvray--1947-%2FPont-de-Saint-Pierre-du-Vauvray-14-.JPG)
/idata%2F0316469%2FCartes-postales-2%2FCarte-postale-de-Pont-de-l-Arche--396-.jpg)
/idata%2F0316469%2FCartes-postales-1%2FCarte-postale-de-Pont-de-l-Arche--199-.jpg)
/idata%2F0316469%2FAlizay%2FAlizay--15-.jpg)
/idata%2F0316469%2FCriquebeuf---Martot%2Fcriquebeuf.jpg)