Le quartier de l'église d'après un détail du plan terrier de la fin du XVIIIe siècle conservé aux Archives de Seine-Maritime (cote 12Fi77) et accessible en ligne.
Presque invisible lorsqu’on circule le long de la route Évreux-Rouen “Les Authieux-sur-le-port-Saint-Ouen” est une bien jolie commune résidentielle qui annonce la couronne rouennaise. Les constructions immobilières s’y succèdent depuis les années 1950. De 326 habitants en 1946 à 1 265 habitants en 2017, les résidences pavillonnaires, consommatrices en espace, ont largement remplacé les anciens vergers, surtout aux Quatre-chênes.
Passées ces constructions nouvelles, voici le cœur du village d’antan : un village-rue dans le sens Gouy-Le Hamel, dans la vallée vers Tourville. Les cartes anciennes le montrent, l’église Saint-Saturnin a été bâtie en haut du val Hamel et, sûrement, là où résurgeait une eau potable ayant creusé et alimenté le vallon. Le clocher de l’église indiquait de loin l’endroit où la voie reliant Rouen à Pont-de-l’Arche, passant donc plus à l’est que celle d’aujourd’hui, formait un carrefour avec le chemin Gouy-Le Hamel.
Le château de La Haye était donc excentré. D’ailleurs, la “haye” signifiait en ancien français un enclos protégé par des fossés et de la végétation dense. Il a sûrement remplacé un ouvrage défensif plus ancien et plus modeste qui barrait cet éperon au-dessus de la vallée tourvillaise.
Dans le cœur historique des Authieux se trouve le clocher en flèche de charpente de l’église Saint-Saturnin. C’est une architecture typique de la région, au moins dans les villages de Boos et du plateau du Neubourg. L’église est humble et basse mais son clocher est visible depuis bien des points de la paroisse et ailleurs, à commencer par les chemins avoisinant le Pré-Cantui, entre Igoville et Ymare. Pour une église rurale, la nef est étonnante par son ampleur et son soin. Elle tranche, en effet, avec le chœur du XIIIe siècle. Avec le clocher, la nef date du XVIe siècle avec des remaniements du premier quart du XVIIIe siècle. Sa décoration est soignée et s’ancre dans une admirable ambiance gothique du début de la Renaissance. Ses baies sont amples et accueillent de belles verrières, du XVIe siècle itou, figurant de saints personnages. Plusieurs de ces baies sont protégées par un classement aux Monuments historiques depuis le 25 aout 1908, il s’agit de : l’Annonciation (baie 1), des scènes de la vie de la Vierge (baie 3), Sainte Anne, la Vierge, sainte Cécile (baie 4), sainte Barbe, saint Sébastien, sainte Catherine (baie 5), Saint Laurent, la mort de la Vierge (baie 7), saint Pierre et saint Michel (baie 8) et saint Saturnin, la Vierge, saint Nicolas.
Vue sur Les Authieux depuis le Pré-Cantui, ou presque, entre Igoville et Ymare (photographies d'Armand Launay, aout 2020).
Que de pieuses références, me direz-vous ? Mais le nom de la commune est doublement pieux : “Altaribus” nom trouvé dans une archive estimée entre 1015 et 1024, signifie les petits autels, les “autilleux” en normand. Ces authieux doivent désigner des oratoires, voire des chapelles, lieux de dévotion populaires autant que modestes étant donné les faibles revenus des quelques familles paysannes résidant ici en ce temps. L’autre partie du nom : Port-Saint-Ouen, provient des vastes propriétés de l’abbaye Saint-Ouen, siège de l’actuelle mairie de Rouen, qu’elles fussent à Ymare, Sotteville ou Les Authieux. Un petit port de Seine fonctionna ici qui alimentait Rouen. C’est même de ce petit port qu’Amfreville-la-mi-voie tient son nom puisque cette paroisse est à mi-chemin entre Rouen et… le Port-Saint-Ouen. La carte de Cassini nous apprend que Les Authieux était le lieu d’un relai postal, c’est-à-dire une poste à chevaux sur la voie Paris-Rouen. Il est vrai que ces pauvres chevaux devaient être bien fatigués par les impressionnantes côtes qu’on vienne d’Igoville ou du Port-Saint-Ouen. Lieu de passage s’il en est, Les Authieux s’est retrouvée sur une des voies majeures entre Rouen et Paris, avec celle du Vexin et celle, sur l’eau, de la Seine.
Les Authieux, c'est aussi le Port-Saint-Ouen, nom du hameau situé le long de la Seine et parcouru par la route départementale entre Evreux et Rouen. Ici d'après des cartes postales illustrées des années 1910.
Le Ministère de la culture a aussi répertorié un logis du XVe siècle, agrandi au XIXe siècle qui dépendait de l'abbaye Saint-Ouen de Rouen. Il répertorie aussi un manoir appelé la Ferme du Clos aux moines et un hôpital placé sous les vocables de Saint-Antoine, Saint-Fabien et Sainte-Madeleine. Celui-ci aurait dépendu de l’abbaye de Bonport. La carte de Cassini le montre, entre le Port-Saint-Ouen et la berge et l'appelle la Madeleine. Le marquis de Belbeuf, auteur de L'histoire des grands panetiers de Normandie et du franc-fief de la grande paneterie, publié en 1856, nous apprend, à la page 22, que c'est Laurent Chambellan, seigneur de Gouy au milieu du XIIIe siècle, qui fonda cet hospice pour les pauvres et les orphelins. Cet hospice a été la propriété des moines de Bonport jusqu'à la Révolution. On n'y disait plus la messe bien avant cet évènement et les bâtiments ont été détruits vers 1836.
L’élément civil notable des Authieux est son château dans son beau parc. Le corps principal, de plan symétrique, est réputé de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Deux bâtiments encadrant le portail sont magnifiques. On en voit les murs pignons avec des parties maçonnées de brique. Ce château fut habité par Maurice Gallouen (1879-1945). Ce médecin installé à Rouen était connu pour son désintéressement et entra dans la Résistance dès 1940. Il cacha des explosifs et des tracts chez lui et soigna des soldats français. Dénoncé, il fut emmené par la Gestapo et déporté à Sachsenhausen en 1943, puis à Bergen-Belsen en février 1945. Malgré sa libération en mars 1945, il resta dans ce camp pour y soigner les survivants dans l’incapacité de se déplacer. Il y mourut du typhus en juin 1945. Les élus ont honoré son dévouement, son humanisme, en donnant son nom à l’un des deux axes principaux de la ville, le second ayant été dénommé rue des Canadiens, les libérateurs venus par Igoville.
Les Authieux, c’est aussi des hameaux tels que Le Clos du Mouchel, sur les hauteurs de Port-Saint-Ouen et La ferme du Bosc, aujourd’hui appelée Les Pointes. À la lecture du plan terrier de la fin du XVIIIe siècle, archivé par le département de Seine-Maritime, cette ferme tenait son nom des immenses vergers qui l’entouraient. Le bosc, mot normand proche du sens de bois, devait donc signifier, au moins dans son acception locale, le verger.
Détails du plan terrier de la fin du XVIIIe siècle conservé aux Archives de Seine-Maritime (cote 12Fi77) et accessible en ligne. Il s'agit de la ferme du Bosc et de Port-Saint-Ouen.
Pour aller plus loin, les amateurs ont la chance de bénéficier, pour cette commune, des écrits d’Henri Saint-Denis, republiés par l’initiative d’Yves Fache, et même d’une étude d’Albert Soboul, historien marxiste de renom en matière de Révolution française ; article disponible en ligne sur Persée et intitulé “Une communauté rurale de Normandie à la veille de la Révolution : Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen”.
Armand Launay
Pont-de-l'Arche ma ville

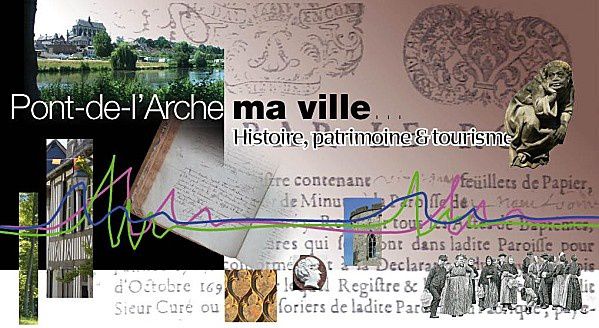
/image%2F0550649%2F20210119%2Fob_1059e7_quartier-du-chateau-plan-terrier-ad7.png)
/image%2F0550649%2F20210119%2Fob_219942_080-001.jpg)
/image%2F0550649%2F20210119%2Fob_62ee92_authieux-port-saint-ouen-chateau2.jpg)
/image%2F0550649%2F20210119%2Fob_6a530e_authieux-port-saint-ouen-route-paris3.jpg)
/image%2F0550649%2F20210119%2Fob_2022d5_authieux-port-saint-ouen-rte-pont-arch.jpg)
/image%2F0550649%2F20210119%2Fob_cc9c5f_645-001.jpg)
/image%2F0550649%2F20210119%2Fob_6bc7c7_authieux-port-saint-ouen-eglise.jpg)
/image%2F0550649%2F20210119%2Fob_7e1343_les-authieux-aout-2020-1.JPG)
/image%2F0550649%2F20210119%2Fob_3d8e86_les-authieux-aout-2020-2.JPG)
/image%2F0550649%2F20210119%2Fob_36c633_375-001.jpg)
/image%2F0550649%2F20210119%2Fob_7c5f22_authieux-port-saint-ouen-grande-rue.jpg)
/image%2F0550649%2F20210119%2Fob_fb6e19_authieux-port-saint-ouen-vedettes.jpg)
/image%2F0550649%2F20210119%2Fob_97dd6f_authieux-port-saint-ouen-vue-generale.jpg)
/image%2F0550649%2F20210119%2Fob_775e69_img1.jpg)
/image%2F0550649%2F20210119%2Fob_5c7426_la-ferme-du-bosc-plan-terrier-ad76-c.png)
/image%2F0550649%2F20210119%2Fob_546a40_port-saint-ouen-plan-terrier-ad76-co.png)



/image%2F0550649%2F20210110%2Fob_18176b_alizay-promenade-sous-les-pommiers-en.jpg)
/image%2F0550649%2F20210110%2Fob_c1155a_2.jpg)
/image%2F0550649%2F20210110%2Fob_6c6e7d_1.jpg)
/image%2F0550649%2F20210110%2Fob_cb521c_p1180402.JPG)
/image%2F0550649%2F20210110%2Fob_380dc4_facade-sud-clocher-et-transept-cot.jpg)
/image%2F0550649%2F20210110%2Fob_446848_jean-pottier-la-cellulose-2-mars-19.jpg)
/image%2F0550649%2F20210110%2Fob_a3c497_jean-pottier-la-cellulose-mars-1971.jpg)
/image%2F0550649%2F20210102%2Fob_5cc9fa_automne-pont-de-l-arche-detail.jpg)
/image%2F0550649%2F20210102%2Fob_50e47c_rue-haute.jpg)
/image%2F0550649%2F20210102%2Fob_905a87_rue-haute-detail-2.jpg)
/image%2F0550649%2F20210102%2Fob_3b4e05_rue-haute-signature.jpg)
/image%2F0550649%2F20210102%2Fob_f4d6f1_ruelles-2.JPG)
/image%2F0550649%2F20210102%2Fob_c13c42_clair-de-lune.jpg)
/image%2F0550649%2F20210102%2Fob_d312ca_alphonse-samain-14.jpg)
/image%2F0550649%2F20210102%2Fob_db68e1_clair-de-lune-detail.jpg)
/image%2F0550649%2F20210102%2Fob_4ff8d9_clair-de-lune-signature.jpg)
/image%2F0550649%2F20210102%2Fob_583143_clair-de-lune-dessin-de-1908.jpg)
/image%2F0550649%2F20210102%2Fob_b58b0d_automne-pont-de-l-arche.jpg)
/image%2F0550649%2F20210102%2Fob_78b640_early-morning-mist-pont-de-larche-clar.jpg)
/image%2F0550649%2F20210102%2Fob_2a8393_clarence-gagnon-pont-de-l-arche-sce.jpg)
/image%2F0550649%2F20210102%2Fob_527dc9_clarence-gagnon-pont-de-l-arche-sain.jpg)
/image%2F0550649%2F20210103%2Fob_bac96c_rue-sainte-marie-comp-gagnon-f-men.jpeg)
/image%2F0550649%2F20210102%2Fob_d6025b_criquebeuf-sur-seine-1907.jpg)
/image%2F0550649%2F20210102%2Fob_7e097b_criquebeuf-sur-seine-detail-1907.jpg)
/image%2F0550649%2F20201220%2Fob_60c43f_heudebouville-le-calvaire-et-la-route.jpg)
/image%2F0550649%2F20201220%2Fob_5c3405_heudebouville-la-grande-route-10-nu.jpg)
/image%2F0550649%2F20201220%2Fob_2603e5_heudebouville-tour-de-l-eglise-constr.jpg)
/image%2F0550649%2F20201220%2Fob_eaa12c_heudebouville-ermitage-de-bellengault.jpg)
/image%2F0550649%2F20201214%2Fob_b4b963_manoir-le-vue-aerienne-de-la-route.jpg)
/image%2F0550649%2F20201214%2Fob_de1f18_le-manoir-vue-aerienne-annees-50-60.jpg)
/image%2F0550649%2F20201214%2Fob_a5e306_le-manoir-vue-aerienne-annees-2020.jpg)
/image%2F0550649%2F20201214%2Fob_4e3fa0_acieries-du-manoir1.jpg)
/image%2F0550649%2F20201214%2Fob_734c0b_bda495528110203927-000011.jpg)
/image%2F0550649%2F20201214%2Fob_7f7e07_bda495528110203927-000016.jpg)
/image%2F0550649%2F20201214%2Fob_d6c745_dsc-1169.JPG)
/image%2F0550649%2F20201214%2Fob_1ab1a0_vitraux-saint-martin-du-manoir-site-d.jpg)
/image%2F0550649%2F20201214%2Fob_319179_hautes-loges-2.jpg)
/image%2F0550649%2F20201214%2Fob_ba7fe7_manoir-des-hautes-loges.jpg)
/image%2F0550649%2F20201214%2Fob_15f66a_le-manoir-des-hautes-loges-frederic.jpg)
/image%2F0550649%2F20210426%2Fob_f7f229_vue-sur-la-haye-le-comte-depuis-la-co.jpg)
/image%2F0550649%2F20201208%2Fob_55a994_la-haye-le-comte-panorama-1920.jpg)
/image%2F0550649%2F20201208%2Fob_32394a_tableau-d-assemblage-detail-1823-g.jpg)
/image%2F0550649%2F20201208%2Fob_508a36_la-haye-le-comte-carte-d-etat-major.jpg)
/image%2F0550649%2F20210426%2Fob_bdc3c3_la-haye-le-comte-frederic-menissie.jpg)
/image%2F0550649%2F20201208%2Fob_9bfb11_la-haye-le-comte-la-ferme-des-herbag.jpg)
/image%2F0550649%2F20201208%2Fob_7e57cf_la-haye-le-comte-27-demeure-1910.jpg)
/image%2F0550649%2F20201208%2Fob_ef8769_la-haye-le-comte-27-la-ferme-du-ch.jpg)
/image%2F0550649%2F20201208%2Fob_fdc0ad_la-haye-le-comte-27-la-chapelle-1.jpg)
/image%2F0550649%2F20201208%2Fob_2fcd52_notre-dame-de-la-haye-le-comte-fondat.jpg)
/image%2F0550649%2F20201122%2Fob_5df19c_cafe-des-sports-16-juillet-1970-jea.jpg)
/image%2F0550649%2F20201122%2Fob_5dae21_femmes-dans-la-rue-sic-16-juillet-19.jpg)
/image%2F0550649%2F20201122%2Fob_9345f2_sans-titre-16-juillet-1970-sic-jean.jpg)
/image%2F0550649%2F20201122%2Fob_574fa8_sortie-d-ecole-13-juillet-1970-je.jpg)
/image%2F0550649%2F20201122%2Fob_f10eea_potager-jean-pottier-21-novembre-197.jpg)
/image%2F0550649%2F20201122%2Fob_4acf68_sabliere-pres-de-lery-par-jean-pott.jpg)
/image%2F0550649%2F20201122%2Fob_d1e612_centrale-hydroelectrique-actuellemen.jpg)
/image%2F0550649%2F20201122%2Fob_3b9b2b_la-ry-vue-ga-na-rale-au-loin-la-ca.jpg)
/image%2F0550649%2F20201122%2Fob_8483b5_la-fabrique-de-pate-a-papier-1910.jpg)
/image%2F0550649%2F20201122%2Fob_2a8df7_le-cafe-de-la-mairie-1915.jpg)
/image%2F0550649%2F20201122%2Fob_334fb4_lery-la-poste-et-la-place-du-calvair.jpg)
/image%2F0550649%2F20201122%2Fob_36bc8c_lery-le-carrefour-8-fi-362-5-ad27.jpg)
/image%2F0550649%2F20201122%2Fob_b823a3_l-hetre-st-ouen-1912.jpg)
/image%2F0550649%2F20201122%2Fob_fe48a1_sabliere-pres-de-lery-par-jean-pott.jpg)
/image%2F0550649%2F20201122%2Fob_f5d58b_image-518.JPG)
/image%2F0550649%2F20201122%2Fob_257b5e_image-512.JPG)
/image%2F0550649%2F20201122%2Fob_aeb248_montaure-l-eglise-8-fi-412-7-ad2.jpg)
/image%2F0550649%2F20201122%2Fob_f3c162_montaure-place-de-l-eglise-le-vieu.jpg)
/image%2F0550649%2F20201122%2Fob_8e90dd_montaure-les-forieres-10-num-5251.jpg)
/image%2F0550649%2F20201122%2Fob_4029d4_acquigny-vue-panoramique-10-num-3.jpg)
/image%2F0550649%2F20210406%2Fob_d9534c_acquigny-chateau-robert-avril-2021.jpg)
/image%2F0550649%2F20210406%2Fob_d6ac9c_acquigny-chateau-robert-avril-2021.jpg)
/image%2F0550649%2F20210406%2Fob_66c556_acquigny-chateau-robert-avril-2021.jpg)
/image%2F0550649%2F20210406%2Fob_28d6fb_acquigny-chateau-robert-avril-2021.jpg)
/image%2F0550649%2F20210320%2Fob_09e17e_2590873.jpg)
/image%2F0550649%2F20201122%2Fob_cea0bd_annie-blanc-1969-sur-la-falaise-au-b.jpg)
/image%2F0550649%2F20201122%2Fob_fcf1bf_ensemble-ouest-et-clocher-a-droite-or.jpg)
/image%2F0550649%2F201304%2Fob_9e233b1c7beafe9c4121bd3e5eded037_bandeau-blog.JPG)
/image%2F0550649%2F20210101%2Fob_b51755_mymap-zoom-pa.jpg)
/idata%2F0316469%2FAmfreville-et-Poses%2FEcluses-d-Amfreville-sous-les-Monts-7-.JPG)
/idata%2F0316469%2FPont-Saint-Pierre-du-Vauvray--1947-%2FPont-de-Saint-Pierre-du-Vauvray-14-.JPG)
/idata%2F0316469%2FCartes-postales-2%2FCarte-postale-de-Pont-de-l-Arche--396-.jpg)
/idata%2F0316469%2FCartes-postales-1%2FCarte-postale-de-Pont-de-l-Arche--199-.jpg)
/idata%2F0316469%2FAlizay%2FAlizay--15-.jpg)
/idata%2F0316469%2FCriquebeuf---Martot%2Fcriquebeuf.jpg)